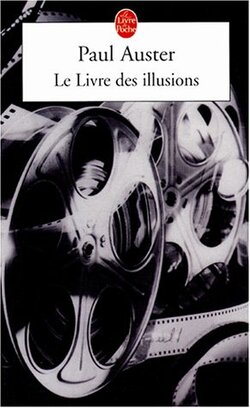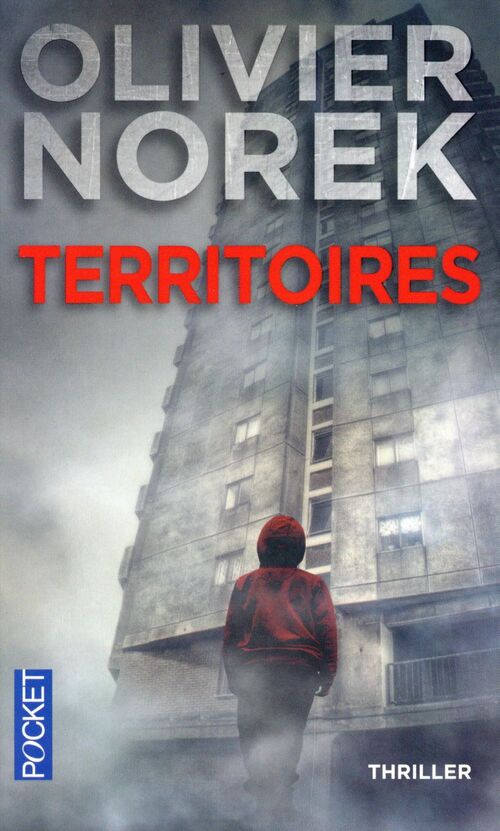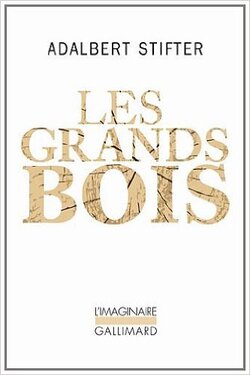-
Par Erlkoenig le 4 Mars 2017 à 10:37
Mal de pierres veut raconter, par l'entremise d'une narratrice parlant d'une de ses grand-mères, l'histoire oubliée des coutumes sardes, des destins ordinaires sacrifiés au nom des impératifs moraux. Parler également d'un mal mystérieux donc, le mal de pierres, qui n'est jamais décrit autrement que comme une propension au malheur, à l'incapacité pour certaines personnes de vivre, au sein d'une société condamnant le regret de ce qu'elle ne peut offrir. L'amour est au centre de tout, bien évidemment, l'amour comme seul élément permettant à ces vies rudes de garder un foyer d'élan vital, celui dûsse-t-il rester dissimulé, ou ne jeter que de lointains feux dans la nuit.
Ce mal de pierres évoque aussi, initialement et avant d'être parfois utilisé pour évoquer les difficultés et drames de certains personnages, l'impossibilité d'enfanter. L'image de pierres, à jamais immobiles et lourdes dans le ventre d'une femme, paraît suffisamment éloquente. Mais on entend également le mal de pierres, semblerait-il, comme un nom dont les termes choisis, tout sauf innocents, ramènerait à l'existence vécue dans ces contrées paysannes, où l'on habite des maisons de granit, où la vie de tous est parfois si dure, le malheur très ordinaire sinon généralisé, et l'ire jetée sur ceux dont on ne sait nommer la faiblesse ; ceux qui, aux yeux de tous, défaillent et succombent à une irrésistible langueur de l'âme. C'en ets trop du destin, ou de son absence. Ce fameux mal évoque donc les destins de nos aïeux, leurs vies souvent marquées de renoncements, secrets parfois, et davantage que la tyrannie des moeurs, ou encore la brutalité des exigences du "vivre-ensemble" d'un autre temps, la forme de courage, de souffrance la plus étanche aux relativisations désolées que produiraient aujourd'hui nos discours : ce haussement d'épaules impuissant, qui ferait dire à chacun : "c'était un autre temps".
Mal de pierres, mal des contrées écrasées de soleils, où les demeures ont dissimulé tant d'existences, à présent illisibles, figées dans l'étrange lumière de photographies en noir et blanc. C'est aussi le message final du roman, qui amène la narratrice à la veille de son mariage ou quelques jours avant celui-ci : face aux morts honorés et impassibles, la fable du destin individuel se déploie à nouveau, et le bonheur est atteint, dans l'antique demeure des ancêtres, où le passé a fini de gronder. Une élucidation de secrets familiaux semble en être la cause. Ne restent que le murmure d'un autre temps, où régnaient la foi, la pierre. Le soleil continue de briller, dévidé de ses poisons.
Mal de pierres se lit vite, et facilement, et pour en rajouter une couche, très plaisamment. La discrétion de ce seul journal intime toutefois, à partir duquel la narratrice dévoile les faits, est à la fois l'artifice qui permet à l'histoire de tenir debout, mais aussi celle qui la limite, même si en l'état, ce n'est pas déjà pas si mal, et plus noble, semblerait-il, que certains récits où les facilités comme le pathos règnent entièrement.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 18 Février 2017 à 23:24
Moon Palace, lors d'une première lecture, m'avait happé comme un roman de Paul Auster sait le faire, c'est à dire dès l'entrée. Les péripéties ultérieures en revanche, me parurent beaucoup moins convaincantes, et très vite. La faute, au moins en apparence, à une trop grande place laissée au hasard, qui, de prime abord et comme l'appellent les écrivains débutants, agit comme un "Deus Ex Machina" ; une situation sortie de nulle part, un ou des évènements dont les ressorts, s'ils permettent de faire évoluer le récit, révèlent trop visiblement leur artificialité. Toute nécessité appartenant au coeur du roman, à son coeur encore informulé à cet instant, paraît en somme étrangère à leur intervention.
Les personnages évoluent dans le vaste continent-monde qu'est l'Amérique, aux alentours des années 70 ; urbains évoluant dans des intérieurs dépouillés, silhouettes vaguement décharnées, qui dansent dans un théâtre d'ombres, faisant peu cas de leur présence en ce monde ; ce qui n'est pas sans rappeler d'autres récits de P.A. Un bref récit fondateur tient lieu d'identité aux protagonistes. On peut parler d'une mise initiale, ou d'un capital de départ, plus vulgairement. Paul Auster laisse clairement apparaître que ces quelques éléments sont les plus essentiels, et que l'autour, bruit comme silence, n'est qu'accessoire. Ce sont leurs tendons, leurs muscles, leur os qui sont la plus sûre preuve de leur existence, et un temps, cela semble convenir.
Ainsi commence l'histoire du personnage principal de ce roman, Marco Stanley Fogg.
Marco n'a pas connu son père ; a vécu avec sa mère jusque vers l'âge de 8 ans, avant qu'elle ne meure écrasée par un autobus. Accident d'une horrible banalité, qui ne laisse place qu'à l'affliction. C'est son oncle qui l'a élevé à compter de ce jour, un Fogg lui aussi ; Marco porte donc le nom de sa mère, ce qui termine de noyer toutes les ramifications du passé, dans une seule et même eau ; un élément, environnement primordial aux bien maigres ressources, mais dont il faut se contenter, faisant face à de hautes murailles d'ombre. Une petite case, aménagée au sein d'un mystère qu'une mince intuition révèlerait branlant. Il faut ajouter que le patronyme Fogg n'est qu'une abréviation du patronyme Foggelman, amputé par un officier d'Ellis Island à l'arrivée, en son temps, d'un pauvre hère, perdu au milieu d'une file interminable de migrants. Fogg n'en signifierait pas moins brouillard, si on n'est pas très à cheval sur l'orthographe.
L'oncle Fogg, joueur de jazz, admet très tôt, à la façon de ces êtres détachés de toute contingence, que le destin même ne saurait faire plier sa nature : il sera incapable d'être un père pour Marco, ou plutôt de le "devenir" pour les besoins impérieux d'un enfant devenu orphelin, mais il sera son ami dévoué, un protecteur distrait, non point dépourvu du moindre projet affectif envers le garçon ; fallot, tout de même. Ses tournées avec les Moonlight Men le mèneront un peu partout dans le pays : non qu'il faille donner toute sa force, tout son art à ce groupe, qui ne connaît que des succès très relatifs. L'errance de l'oncle Victor a davantage a voir avec celle du déracinement. Le moindre souffle de vent semble le porter vers son destin, vers une vie que seule de moindres soubresauts dérange ; une rencontre amoureuse sur le tard, avec une femme alcoolique, qu'il aimera pourtant ; un manque de sérieux chronique dans sa pratique musicale, qui le condamne, sans qu'il aie la ressource même de s'en émouvoir, à une forme d'indigence. Le plus souvent on le découvre l'index levé, en plein échange nourri avec son neveu des signes étranges qui éclairent une destinée. La vie de Marco en est pleine, selon lui, et le neveu, sans y croire tout à fait, conscient sans doute que la fréquence de leurs échanges à ce sujet, que les esquisses divinatoires et fantaisistes tentées par l'oncle participent d'un subtil rituel de compagnonnage, d'affectivité, davantage que d'évènements à attendre, se laisse pourtant tenter par le vague onirisme qui émane de l'oncle Fogg, lequel a surnommé son neveu Phileas. Un oncle émacié, tiraillé par une vie de bohême sans les idéaux caractéristiques qui l'accompagnent souvent, dont la vie est une énigme, dont le regard perce pourtant le lointain brouillard, amoncelé vers les marges : son expérience, comme les préceptes qu'il en a tirés, entre un étrange tarot existentiel et la nécessité de subsister, suggèrent que l'âme, sans cesse, est sur le départ. Ainsi lorsqu'il viendra à mourir, loin de chez lui, Marco à peine devenu majeur, il laissera somme toutes un jeune homme deux fois orphelin, et peu préparé à survivre à la mort de son dernier parent. A l'université, Marco perdra peu à peu contact avec son destin d'étudiant. Il lui faut lui aussi aller quelque part, puisque c'est à cela qu'il est promis, mais où ? Il lui faudra emprunter la voie de la disparition, de la dislocation. Puisque nulle géographie ne peut convenir, puisque n'existe nul pays où se rendre et être chez soi.
Le vent du changement vient du fonds des temps, réclamer son tribut ; il souffle pour dépouiller, peu à peu, Marco Stanley Fogg de son identité. Rien ne semble plus le tenir, il va frôler la mort, au terme d'une longue période où il pousse son corps vers une expérience extrême de dénutrition, aidé en cela par la ruine de ses moyens financiers. Il va rencontrer, par hasard, mettant un terme à son errance, une présence féminine dont l'amour va causer en lui "un spectaculaire effondrement de parois intérieures".
Mais ce n'est que le début. Qu'une mise en bouche.
Placé sous le signe du hasard, de l'invraisemblable hasard, Moon Palace rend compte de l'étrange éloquence du destin, lorsque de très puissantes polarités l'orientent. Sous les signes de la lune, M.S Fogg va découvrir sa véritable identité. Les pages se succèdent : on le croise, au début du roman, misérable étudiant, si égaré qu'il porte le costume élimé de son oncle mort, dans une singerie presque consciente et protégée, un temps, du désespoir ; on le retrouve guéri, plus loin, de son manque d'attaches, au service à domicile d'un mystérieux vieillard acariâtre puis enfin, au bout de la route, criblé d'un savoir qu'il ne demandait pas, mais qui a fondu sur lui de la manière la plus impitoyable, mais aussi la plus miséricordieuse qui soit.
Au final, Moon Palace est fascinant. Les défauts que je m'étais formulés au départ sont certes présents, mais ils s'intègrent parfaitement à la trame du roman.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 26 Septembre 2016 à 11:09
La première fois que j'ai vu la couverture de ce livre, en l'occurrence ces fusées lancées vers l'espace, je n'y ai pas même prêté attention. L'imagerie de la science-fiction est trop familière pour se déployer avec innocence sous nos yeux.
Il y avait pourtant beaucoup de choses à y voir ... ceci sans doute est plus aisé à remarquer, ma lecture achevée. En premier lieu le dessin est plutôt réussi. J'aurais pu noter que les dégradés de bleu représentaient autant, au plus bas, la mer et ses vastes profondeurs, d'où la vie sortit un jour, que notre ciel "immédiat" en remontant, puis l'infini de l'espace. Un paysage qui évoque le rêve, et le drame, suggérant l'idée du départ, comme de l'origine.
Ces 12 fusées, figées par le dessinateur Manchu dans un envol semblable à un ballet, semblent dire la majesté de toutes les tentatives humaines, et la fragilité de l'élan qui les porte. C'est ce que Spin donnera à voir, tout au long de ses 550 pages : les grâces autant que les dérives de l'humanité, mises en scène au travers de la grande Histoire, et de quelques destins individuels.
Un artefact technologique inconnu apparaît une nuit sur Terre, masquant les étoiles d'une seconde à l'autre. Il s'agira dans un premier temps, pour les esprits médusés, de le nommer Bouclier d'Octobre. Sa présence et ses effets révèlent peu à peu aux gouvernements de la Terre qu'à l'extérieur de cette membrane, le temps s'écoule des millions de fois plus vite. Ils en acquièrent de solides preuves, tandis que le fameux Bouclier, qu'il conviendra alors d'appeler le Spin, reste parfaitement muet, étanche et fonctionnel, conduisant la Terre emprisonnée vers son destin cosmique, et notamment vers ce jour où elle s'approchera du soleil jusqu'à en être carbonisée.
Pour les enfants de la génération Spin, il faut pourtant vivre, dans cette atmosphère de fin du monde où pullulent les églises millénaristes, tandis qu'un nouvel organe de la NASA, Périhélie, conduit des recherches sur le Spin, que l'on espère salvatrices à long terme. On retrouve tout autant de disparités dans l'accès et la compréhension de l'information "globale", qu'à notre époque et dans notre réel, où la complexité est capable de noyer l'esprit le plus vaillant ; ainsi le Spin est-il, pour des continents entiers et à différents degrés, une chimère, ou une technologie américaine aux visées mystérieuses, à moins que ce ne soit une intervention d'extra-terrestres (que Périhélie envisage de la façon la plus sérieuse).
Ce qui conduit ces hommes désespérés, et surtout l'homme de science, c'est la recherche du sens. Un sens à découvrir avant de mourir. Une quête scientifique, rationnelle pourrait-on dire. La fin des temps, mystique ou non, semble avoir devancé leur espoir et l'attente d'une compréhension. Elle vient leur signifier qu'il ne leur sera pas donné d'expliciter la disparition de l'espèce, malgré leurs capacités cérébrales et leur soif de connaissance, qui jusque là restait leur salut. Comme voudrait le suggérer R.C Wilson, ces faits, qui mobilisent tant les civils que les militaires, ne suffit pourtant pas à élever toutes les consciences vers le haut. En écrivain du présent, l'auteur dépeint à merveille, à travers le filtre du Spin, nos existences ordinaires, un certain malheur existentiel, et l'incrédulité qui nous frappe et nous pétrifie, face aux défis majeurs que l'humanité sait devoir relever.
A bien des égards, l'idée de fin du monde nous touche plus souvent, peut-être, que nous ne le souhaiterions. C'est à cela que nous devons nous confronter en lisant Spin ; R.C Wilson pourtant, loin d'agir en démiurge froid et technologisant, en traitant dans sa narration de la question hautement mystérieuse du Spin, choisit de nous faire vivre cette aventure en humains, en mettant en scène les passions qui nous animent, de la plus humble à la plus élevée. Il dessine en passant les contours du rêve d'une plus haute humanité, enchaînée à son besoin de survivre, triomphante, peut-être, et prodigieusement intelligente, capable. Davantage qu'au travers d'idées politiques ou religieuses, on voit se former, vers la fin, dans l'incroyable écheveau du présent, bouillonnant de matière, un horizon métaphysique dont les arabesques jamais n'achèvent la quête du sens, qui surgit comme revivifié au terme de ces pages.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 3 Juillet 2016 à 12:01
Lorsque j'ai découvert Paul Auster, à 20 ans et des poussières, je ne lisais plus, ou si peu, depuis des années ; quand vos derniers souvenirs de lectures concernent massivement des page-turners, (de très bons Stephen King, mais ne le résumons pas à cela) (ou encore quelques épopées signées Anne Rice, très appréciées en leur temps) et quelques grands classiques adulés, la narration de P. Auster a de quoi vous mettre un véritable coup de fouet. A l'époque, ce fut la Trilogie New-Yorkaise qui m'administrait les premiers sacrements de ce qui devait être une renaissance à la lecture.
"Le Livre des Illusions", un titre que l'on pourrait facilement qualifier de laborieux, ayant peut-être même l'air de sortir d'un générateur, n'est peut-être pas le meilleur Auster. J'entends déjà dénoncer ses défauts les plus évidents par certains : ceux-là seront soit des renégats, revenus de leur admiration première -j'en fais un peu partie- montrant quelques signes d'agacement compréhensibles, soit d'authentiques amateurs de l'oeuvre, enclins à la juger avec davantage de bienveillance ; ils s'opposeront, je l'imagine, en tout.
Si vous ne connaissez pas encore Paul Auster, oubliez les repères traditionnels qui nous sont depuis toujours donnés à la lecture d'un livre, ou les formes plus éprouvées, plus sages et lumineuses (bien que P. Auster n'offre pas non plus un brillant exemple de littérature complètement déjantée ou déstructurée), entendre là un terrain fictionnel auquel nous serions tout à fait préparés. Plutôt que de plonger son lecteur dans le confort et la gentille impatience, lui ménageant régulièrement et si possible dès l'entrée de bas effets de manches de romancier professionnel (dans le pire sens du terme), il commence bien souvent par produire en lui un état proche de la sidération, en lui dévoilant le destin brisé d'un personnage, dont l'âme est, jusqu'en son centre, hantée par un désastre sans précédent. Au lieu de devoir nous acclimater à lui, ou à eux, on observe leur situation en refusant d'y adhérer tout à fait, comme l'on répugnerait, si c'était seulement possible, à voir son identité s'effriter et chercher, du bout de ses incertains lambeaux, une raison de prolonger notre survie. Pourtant, nous sommes très tôt rivés à leurs errances ; c'est qu'à ce propos rien n'y semble gratuit, et que l'on assiste, on le sent, à une tragédie.
Après ma malheureuse lecture de Léviathan, je me suis donc laissé reprendre par la main, ou plutôt montrer le champ de ruines attenant, celui de la vie de David Zimmer, au commencement de ce roman. Sa femme et leurs deux enfants ont trouvé la mort simultanément, sans raison, sans l'ombre d'un sens apparent, durant un accident d'avion. Il n'était pas à leurs côtés, un peu par un second et cruel hasard, mais aurait fort bien pu s'y trouver, et la conjonction de ces faits, sans compter sur l'agonie de sa famille, qu'il ne peut s'empêcher d'imaginer, le plongent dans la déréliction. Il n'y a semble-t-il plus rien à faire pour la vie, qui continue, monstrueuse, intacte bien qu'à jamais renversée. Le destin va pourtant mettre en branle une incroyable machinerie, par le biais du seul hasard qui semble continuer de payer, en une étrange monnaie, pour travailler les tourments de Zimmer, les façonner tels un mystérieux visage. Il rencontrera en effet sur sa propre télé Hector Mann, acteur virtuose du cinéma muet du début de siècle ; au gré de nombreuses pirouettes, affublé d'une moustache comme dotée d'une vie propre et touchée par le génie, celui-ci parvient, dans un complexe entremêlement du tragique et de l'humour, à arracher à Zimmer un rire clair, sonore, aux petites heures du matin. Ce rire, cet éclair survenu au beau milieu de sa vie, l'a arraché, quelques secondes mais plus durablement encore, à l'état d'hébétude alcoolique dans laquelle il se débattait.
Un dessein invisible est déjà à l'oeuvre : Zimmer va chercher à visionner tous les films de Hector Mann, et à en savoir le plus possible sur cet homme, qui a disparu à la fin des années 20, et que le monde entier s'est empressé d'oublier. Zimmer, lui, s'accroche à l'oeuvre de l'acteur-cinéaste comme un homme se tient à quelque morceau d'épave en pleine mer, et entreprend de lui consacrer un livre, le premier jamais écrit. Sa tâche s'avère plus délicate que prévue. Il découvre notamment l'aspect pour le moins mystérieux de sa disparition, et le flou que le monde du spectacle, entre interviews et journalisme de surface, n'a pu dissiper à propos des origines de Hector Mann. Zimmer, néanmoins, parvient à ses fins et fait diffuser son livre.
Un beau jour on lui écrit de l'autre bout du globe, pour lui signifier qu'Hector Mann a lu et apprécié son livre, et qu'il souhaite vivement le rencontrer, au Nouveau-Mexique. Le hasard a depuis longtemps cessé d'opérer. Une force, un lien indestructible a émergé du néant, d'un bref et méconnaissable éclat de rire en son temps, et la vie de David Zimmer n'a plus qu'à suivre à rebours ce fil d'Ariane, qui s'était matérialisé de façon ténue tout d'abord, jusqu'à devenir la veine principale de ce destin retrouvé, mais encore boiteux.
Qu'y a-t-il à son bout ? Hector Mann, l'attendant patiemment, vraisemblablement à la toute fin de sa vie ?
Paul Auster réussit cette fois à captiver, non sans jeter le trouble dans l'esprit de son lecteur, pris de vertiges face au récit de ces vies gigognes, et face à l'absolutisme de H. Mann. Devant cette avalanche de révélations, jusqu'à l'altération probable, finale, de la réalité, c'est encore une fois l'identité qui est au centre du roman, celle qui ne nous sert, chez Paul Auster, qu'à marcher vers l'ailleurs, où nous attend la dispersion de tout ce que nous avions, et de tout ce que nous étions. La création, tant chez Mann que chez Zimmer, ou encore chez Alma, ne peut endiguer la vie, mais la double néanmoins, la soutient, jusque dans les régions les plus reculées de l'existence, faisant émerger de nouvelles terres.
Le voyage est éreintant, parfois outrancier, surtout vers la fin. A l'occasion on se surprend à trouver que dans sa grande efficacité narrative, Paul Auster oublie de fixer plus longuement son regard sur cette histoire, et sur sa bouillonnante présence humaine, dont les remous semblent parfois submergés dans l'immense courant, mouvement même de la folie de soi, que génère la tragique et lumineuse histoire de H. Mann ; peut-être ces personnages, en somme, semblent-ils trop broyés et anéantis, en tant que personnages, par cette dernière. Mais ce qui ne nous apparaît pas, à la lecture, comme un mystère, c'est que Paul Auster dépeint parfaitement ces vies, y compris celle de Mann, et nous gagne à la fascination qu'il exerce sur les protagonistes de cette histoire. Ils vacillent autour de leurs propres raisons de vivre, ayant à la fois trouvé là leur soleil, et peut-être aussi le chemin qui leur est désigné, à la surface de la terre.
Au terme de ces pages vient le soulagement, et on laisse Zimmer, baignant dans la lumière aveuglante de ce même soleil, et du passé, seule trace de ce qu'il est, et de ce qu'il peut encore devenir. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 26 Mai 2016 à 09:47« Ah, il faut absolument lire Olivier Norek, et ces intrigues, dignes d'un excellent polar urbain ! » Et ledit O. Norek, invité d'une émission littéraire, de sourire avec un air pas tout à fait entendu, presque touché, ravi d'être « là », pour ainsi dire. Bien sûr qu'Olivier Norek, l'auteur de Code 93, Territoires et Sur-tensions est sympathique, tout comme il ne prétend pas forcément y toucher ; tout de même nous servira-t-il le couplet, sincère, du type à qui un professeur de français conseillait de ne jamais écrire, tout comme il nous entretiendra de son parcours d'autodidacte, de lecteur intuitif, sans parvenir à cacher ce qui ressemble à une joie un peu naïve. Il y a peu, O. Norek était « flic », et maintenant qu'il écrit des polars on lui laisse entendre, un peu partout, qu'il connaît son affaire, qu'on s'éclate à le lire.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 5 Janvier 2016 à 19:44
Aucune envie de pratiquer le langage du compte-rendu, pour parler de la seconde incursion de Dominique Ané dans l'écriture de fiction.
Il suffit de dire que nous tenons là une suite de petites histoires du quotidien, que l'on nommerait volontiers nouvelles. D'une langueur écrasée, inquiète, comme le souligne l'éditrice, elles ne suscitent jamais l'ennui, et touchent juste, très juste parfois.
Un petit livre indispensable, de ceux que l'on s'offre en cadeaux, et qui fait taire les heures. On se surprend à lire lentement, pour que ça dure, encore un peu plus longtemps. C'est un tout petit livre. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 5 Janvier 2016 à 17:48
En commençant le "Journal" de Jean René Huguenin, je cherchais à entendre la voix d'un homme, jeune peut-être, face à sa tâche d'écrivain ; je cherchais à l'entendre résonner à travers temps et époques. On peut trouver de telles choses, en parcourant ce Journal. On trouvera surtout un jeune homme qui non seulement écrit, mais se trouve en butte à son implacable devoir d'exister.
Comment prendre l'exacte mesure de cette existence, stoppée de façon aussi anecdotique, terriblement impersonnelle ? L'accident de voiture qui devait coûter la vie à J.R.H, à l'âge de 26 ans, rappelle avec quelle prudence la destinée sait se manifester. Son Journal, tout du long, nous annonçait l'éclosion d'un homme, ou d'une individualité acerbe, se débattant déjà (et depuis quand ?) contre les conformismes bourgeois, l'étroitesse, non seulement d'esprit mais aussi de vue, de coeur, (ou de souffle) de ses semblables ; cherchant déjà par quel douloureux apprentissage il parviendrait à les cotoyer, il n'a presque aucun doute quant à la voie qu'il lui faut emprunter, et ce n'est pas se draper dans sa superbe que d'envoyer valser les pâles figurines du quotidien, lorsque celles-ci freinent, chaque minute, son ascension vers la joie de "devenir", toujours opposée au sentiment, repu, de celui qui demeure et s'y complait.
Le questionnement de J.R.H, quant à sa condition, est marqué par son extrême jeunesse, même clairvoyante, même remarquablement en pieds ; on n'a pas à lui pardonner ses intransigeances, car en lui rien ne souhaite être pardonné, ni aimé. Il est froid, étincelant, prêt à mépriser sa vie si cela peut le conduire vers ce qui mène à s'oublier, à "croître", car ainsi en va-t-il de l'âme pour J.R.H.
Nous nous tenons parfois à respectable distance de ce chemin solitaire. Sa lumière l'exige ; ce n'est pas une lumière qui rassemble dans l'heureuse communion, mais celle qui réfléchit, qui chasse vers soi, de nouveau, et qui, donc, confronte. Très beau livre, de ceux, j'imagine, qui sont tels "une hache pour fendre la mer gelée en nous".
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 26 Juillet 2015 à 21:49
Les grands bois, ces immensités de Bohême, ont été aimés, rêvés, parcourus par Adalbert Stifter. Peut-être souhaitait-il, à travers ce récit, les rendre à leur innocence, à leur impassibilité face au chaos propagé par les hommes.
La Guerre de Trente Ans épargnait jusque là les terres d'un vieux seigneur veuf, avec ses deux filles vierges, ainsi que ses gens. La guerre s'approche néanmoins. Ayant eu connaissance, de par une ancienne amitié, d'une retraite sûre au fond des bois, il pense trouver là de quoi mettre ses filles à l'abri. Lui restera au château, le temps de voir, espère-t-il, les colonnes passer seulement au loin de ses murs.
Stifter s'est attaché à peindre ce que sont les espoirs, les sentiments de ces jeunes filles raisonnables, tremblantes, dans l'attente de leur père, retranchées avec quelques hommes de confiance dans la maison des bois. Durant deux saisons, le récit se donnera l'occasion de célébrer les splendeurs de la nature, dont l'oeil guérit, trompe le temps, avant de l'ensevelir.
L'histoire se répartit en chapitres, aux noms évoquant autant de variations autour d'un même sujet de composition, qui est la forêt ; la pratique naturaliste de A. Stifter, visant aussi à la peinture des âmes, présente les faits avec une prudente fatalité, selon une tournure qui paraîtra très académique, même si non dénuée d'intérêt. Le tout ressemble, dans une étrange absence même des protagonistes, au fragment d'une intention, à une figuration onirique, finement ciselée, aimable comme ce qui, au-delà de son lot commun, sait aussi se révéler particulier ; ainsi les merveilleuses scènes durant lesquelles Johanna et Clarissa observent du fond de leur retraite, à la jumelle, le lointain château de leur père, dont elles attendent le retour, avec une gaîté sans cesse ravivée. Stifter a-t-il cherché à peindre la forêt, le destin ? Tout est fondu d'un seul trait.
Il faut lire " les grands bois " pour ses visions apaisées de la Nature, dont la vitalité lente et assurée expose, autant qu'elle berce, les désarrois humains. La grande qualité de ce livre est enfin de nous plonger dans une vie dépouillée de ses artifices ; A. Stifter nous parle depuis ce refuge éloigné de la société qui, s'il n'est pas épargné par les vicissitudes du monde, espère préserver la clarté du sentiment, et une certaine noblesse d'esprit.
Ce à que nous pourrons nous aussi participer, en offrant à ce court volume la lenteur nécessaire à sa découverte, et à son "retentissement". votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 1 Mai 2015 à 16:49

Je me proposais, depuis longtemps, de faire connaissance avec l'oeuvre de Fabrice Colin. C'est chose faite, avec ce premier livre de l'intégrale "Winterheim", chez J'ai Lu.
L'auteur écrit beaucoup. Pour la jeunesse, pour l'amateur de fantasy, concernant le présent Winterheim, ou encore pour un "public" que l'on n'identifiera guère plus précisément. On reconnait le parcours de F.Colin à des incursions successives dans le fantastique, le policier (plus récemment) ou encore le merveilleux, au delà des marges. Une littérature abondante donc, mais dont la trajectoire ne semble rien devoir à un quelconque déterminisme.
Si j'ai de mon côté choisi Winterheim, c'est sans doute qu'il me fallait, en guise d'approche, un objet reconnaissable, aux frontières probablement bien définies. Cible parfaite que cette trilogie de fantasy donc, écrite tôt dans sa vie d'auteur.
Je ne peux assurer à celles et ceux qui liront cette "chronique", amateurs de fantasy notamment, qu'ils trouveront là leur parfait bonheur car je ne vois pas, par exemple, de "système poussé de magie". (Ce genre de considération me fait souvent grincer des dents) Il y a bien, cependant, une carte du monde, assez sommaire et peu soucieuse de figurer d'autres reliefs que ceux des montagnes, lesquelles divisent, avec un delta au sud, un monde continental en gros territoires. le plus au Nord est celui d'Asgard, où les Faeders, dieux des humains, se sont retirés en accord avec leurs principaux opposants, les Dragons, ceci afin d'empêcher d'autres désastres, liés à leurs continuels affrontements.
Ce monde inspiré des mythologies nordiques est celui où, tôt ou tard, seront précipités de nouveaux cycles historiques, car des vengeances, des complots sont encore fomentés par les Faeders ; on nous présente leur constellation à travers un arbre généalogique.
Le récit commence avec l'apparition, dans les affaires humaines, de quelques uns de ces dieux. Leur présence est toute l'essence de cette première partie ; suivant leurs agissements, dont les desseins existent sur un autre plan, nous sommes mêlés à l'histoire tragique de la caste régnante du royaume d'Elsnör. Son Roi, manipulé par une mère perverse, porte atteinte à la divinité de la nuit en la capturant, et en la retenant contre son gré. On sent que cette jeune fille diaphane, absente au monde et portant avec elle toute les apparences de l'humanité, a révélé sa fragilité et son incapacité à se défendre comme seul un dieu peut le faire, persuadé, peut-être, que la tabou absolu de sa seule existence, ordinaire et exposée, le tient à l'abri des habituelles malveillances humaines.
Le bras armé de la mystérieuse machination en marche, dont nous ne savons rien ne peut être, donc, qu'un esprit malade, qui provoquera ou accélérera la perte de nombres de ses semblables, en ayant provoqué la colère des dieux.
Ces passages s'enracinent dans un style allusif, intégrant dans son appréhension du monde et de la réalité la présence - fantastique - des dieux, qui foulent la même terre que les hommes, et dont la présence ne peut-être révélée qu'avec l'absorption d'un filtre magique. Ces évènements ont une portée que l'on devine démesurée, ils sont comme le point d'orgue dans l'histoire du basculement à venir ; c'est ainsi qu'à la fin de ce premier "mouvement", morceau d'histoire récente aux apparences de légende, on passera à la suite du récit, en d'autres années, sous des regards et des auspices différents.
Passées les premières impressions poétiques, l'histoire semblera s'attacher, avec un talent certain, à un personnage dont l'existence va se trouver irrémédiablement bouleversée.
Le thème de la vengeance y est traité avec réussite. Fabrice Colin semble avoir eu l'intuition que ses personnages, à défaut d'être bavards, gagneraient à souffrir de passions universelles et facilement appréhendables par le lecteur ; mais il les fait affleurer en en maîtrisant les tenants et aboutissants de la plus parfaite manière. L'exil intérieur du héros, soumis à la tyrannie des assassins de Walroek, est poignant. Le thème pourrait sembler affreusement convenu, et pourtant, son absence, sa détermination de jeune homme meurtri semblent vrais, construits, vécus. de même, l'ombre de puissance qui l'habite, et qui grandit sous nos yeux est en équilibre avec la terreur qu'inspirent les soldats envahisseurs de Walroek, et leur chef abject. Une force gronde, on devine à quel genre de destin il semble être appelé, même s'il sert un dessein supérieur.
En sa qualité de trilogie, la lecture de ce premier tome ne saurait se suffire à elle-même. Il faudra donc que je lise la suite. Ce sera avec plaisir. C'est incontestablement un bon moment de lecture, même si certaines scènes (je pense par exemple au dîner où le draaken a convié les dirigeants des royaumes voisins ; à l'incursion dans le labyrinthe ...) sont trop candides et ont imprimé au récit, dans la stabilité de l'univers jusque là développé, une tournure pas forcément bienvenue selon moi. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 15 Avril 2015 à 21:53

En s'avançant sous les ombres conjuguées de Robert Holdstock, de André Dhôtel, de Marcel Brion, ou que sais-je encore, d'un "évanescent Domaine" rappelant " l'Antique Parage Interdit" de Lavondyss, La Lisière de Bohême avait tout pour retenir mon attention.
Des trois auteurs nommés plus haut je ne connais que Robert Holdstock, certes. Je ne vois pas pourquoi je me serais privé d'une telle énumération ; elles tiennent lieu, d'ordinaire, de parfaites entrées en la matière. Un feignant aurait tort de s'en priver.
Le point de départ de ce roman : un vieil écrivain, cloîtré dans sa cabane de forêt, où il poursuit l'un de ses derniers travaux. Il reçoit la visite d'une randonneuse, beaucoup plus jeune, et tandis qu'ils se mettent à deviser, diverses coïncidences, un flux de synchronicité croirait-on, leur apporte l'intuition que leur rencontre n'est en rien dû au hasard.
Pour tout dire, ma description de "La Lisière de Bohême" pourrait s'arrêter ici.
Avant même d'avoir pénétré plus loin, là où commence la forêt, à sa lisière donc. Cette frontière qui éprouve le regard, et nous défie, oui, dans sa "fixité", son immobilité de façade. Une grande partie des charmes de ce livre se déploie dans l'évocation, l'oralité. Ce n'est pas pour rien que chacun de ses courts chapitres s'ouvrira, d'abord, sur une exergue, une trace laissée par d'autres auteurs dans la mémoire de Jacques Baudou ; ils forment, à eux tous, une tradition, la leur, et inévitablement, la sienne.
Davantage qu'un mystère à résoudre, l'histoire que nous conte "La Lisière ..." est celle d'un espace rêvé, à portée de main, invisible peut-être, mais après lequel il nous faut pourtant courir. Il évoque le plaisir de parler, de transmettre, la clandestinité des âmes, la passion des questions plutôt que des réponses, ou encore des éditions régionalistes. Du peu, du bien et du tant.
Tout n'y est pas parfait. Certains soulèvent quelques défauts qui me paraissent évidents, mais qu'il paraît presque cruel de relever, car l'intérêt de ce roman se situe véritablement ailleurs. J'ai encore la sensation d'avoir entrouvert un bosquet hors d'âge, où dorment, et dormiront encore ces souvenirs de vies inconnues et passées. Rien n'est venu gâcher mon plaisir.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 22 Janvier 2015 à 19:49
J'ai entendu les premiers chapitres de ce livre il y a quelques paires de mois. C'était lu, peut-être par l'auteur en personne, et accompagné d'un fond musical à peine perceptible (Florent Marchet?). C'était sur France Culture.
On percevait aussitôt une tonalité très éteinte dans ce récit, qui se présentait sous la forme d'un journal, lu donc par un comédien , et dont les mots résonnaient dans un for intérieur coupé de toute urgence, baignant dans une mélancolie diffuse.
C'est ce même récit, mot pour mot, que j'ai découvert, sans le son cette fois. Aurélien Delamare, double supposé de l'auteur, se retrouve en Normandie pour le compte de son frère aîné et de ses parents. D'une façon caractéristique qui, apprend-on, continue de marquer les rapports internes de cette famille, il s'est décidé, dans le dos de l'éternel benjamin, que la maison familiale serait vendue. Il ne saurait, à 35 ans révolus, manifester de sérieuses oppositions à ce projet ; en sa qualité d'adulte d'une part, mais aussi, de façon paradoxale, dans son caractère de petit dernier, habitué à s'effacer et à s'isoler devant les cas de "force majeure", qu'ils relèvent de la raison parentale, ou du caractère flamboyant d'un frère aîné.
Encore hanté par une rupture difficile avec Junon, il y a quelques années, Aurélien ne parvient pas à s'extraire d'un certain enfermement, d'une douleur qu'il ne cherche même plus à fuir. C'est dans ce contexte, dépêché par son frère indisponible, qu'il se rend sur l'ancien lieu de vie familial, près de la plage, avec pour mission de faciliter la prise de contact avec l'agent immobilier local. Le temps, sous la forme d'une mise en vente, s'apprête à ensevelir une partie de sa vie ; et il ne sait même pas si cela doit lui causer quelques nostalgie, et si tout ne doit pas, finalement, se fondre dans le même noir univoque du présent. C'est dans ce chaos que le cafard commence à lui faire signe, de façon insistante, que les amitiés anciennes laissées sur place resurgissent, qu'on s'attende à les retrouver un peu plus ridées, ou mangées par les vers.
Une mélancolie écrasante aurait constitué un écueil certain pour le récit. Au lieu de ça, c'est plutôt cette distance maladive d'avec les choses, ce manque de certitudes sur le ressenti, qui délimite le territoire de cette voix, et de ce sur quoi elle pourrait bien se pencher.
Cette distance est l'un des atouts du livre, mais aussi l'une de ses relatives faiblesses. C'est que les personnages, pour le peu que l'on nous les dévoile et s'ils s'incarnent assez facilement, semblent à peine effleurés, les destins sans consistance aucune, et les caractères des uns et des autres finalement assez caricaturaux. Peu importe, on imagine, qu'il s'agisse peut-être de portraits fidèles : l'auteur semble les avoir davantage mentionnés pour lui que pour un hypothétique lecteur. L'effet produit est plutôt curieux. Le malaise du personnage principal ne se dissipe pas vraiment (ce qui est une bonne chose), mais la sensation qui domine est celle de se retrouver devant un roman, et un narrateur un brin "tricheurs" : il y a un début, une fin, mais on n'a pas creusé grand chose, tout au plus nous a-t-on présenté la famille et quelques névroses persistantes, et quelques unes, peut-être, des influences littéraires. C'est élégant, mais aussi un peu vain.
Etrange objet. Cette lecture m'a quand même happé, et parlé plus d'un titre. Cela ne suffira pas, toutefois, à en faire une expérience beaucoup plus remarquable.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 18 Janvier 2015 à 18:19
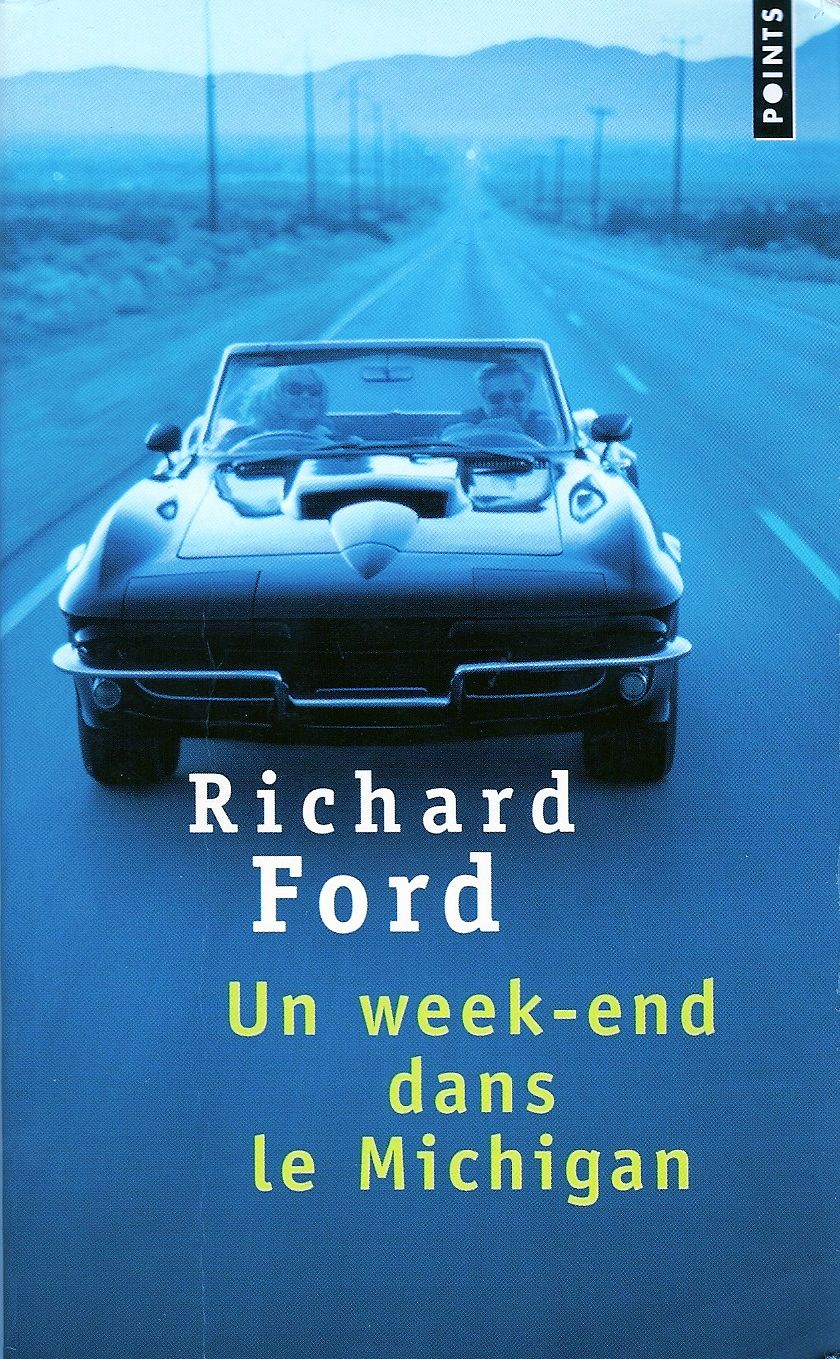
J'ai découvert Richard Ford à cause de l'émission "les carnets de voyage de François Busnel". Il y a mille raisons imbéciles de prétendre qu'on a choisi de lire ceci, ou cela, alors je n'ai pas peur de vous donner les miennes : les yeux translucides de l'auteur, ses traits, où semblent flotter une vague folie, et la distance qu'ils semblent avoir prise d'avec le monde m'ont fasciné. Enfin, Richard Ford écrit ses romans sur des feuillets détachés, d'innombrables feuilles volantes dont il sait bien sûr reconnaître l'ordre et la succession. Ces mêmes feuilles raturées au possible, où une encre rouge fait quelques apparitions par endroits, ont achevé de rendre l'auteur sympathique à mes yeux.
On tombe certainement de haut, parfois, à choisir un livre de la sorte. Mais tel ne fut pas le cas ici. J'écrirai peut-être une note de lecture plus tard, au sujet d' "Un week-end dans le Michigan". En attendant, je vous renvoie bien volontiers aux impressions d'un autre lecteur, qui m'ont semblé parler à ma place.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 7 Décembre 2014 à 22:13

"J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui, mais ce type est dingue." Ainsi John Gardner conclut-il sa section préliminaire de remerciements.
[...]
Voilà une façon un peu rapide de régler son sort à Peter Mickelsson, le personnage central, personnage-monde, pourrait-on dire, de la Symphonie des spectres.
Il y a dans cette phrase plus haut, de la part de l'auteur, comme une sorte d'ultime adresse de cogneur de comptoir, un crachat, une bravade inattendue. En se déchargeant, sur un mode grinçant, du fardeau porté par son personnage, John Gardner (à ne pas confondre avec son homonyme britannique, qui a notamment écrit quelques unes des aventures de James Bond, sinon des novélisations) semble le reléguer à son étrange existence de papier, faisant l'impasse volontaire sur les limbes, siennes peut-être, qu'il a arpentées pour créer ce personnage. Les siennes, ou peut-être les nôtres.
Cette mise en garde nous trouverait pourtant difficilement préparés à la lecture de la "Symphonie des Spectres". Le texte ("Mickelsson's Ghosts" dans sa version originale) alterne, avec beaucoup d'adresse, entre éléments structurant le récit et intrusions dans l'esprit tourmenté d'un homme, qui semble vouloir isoler, traquer en lui la moindre et irréductible part d'humanité, afin de l'exposer au rayon diffractant de sa pensée. En toile de fond, l'histoire d'une vie ancienne, encore saignante de ses derniers écueils : la séparation d'avec une femme aimée au passé, et peut-être encore au présent, l'éclatement d'un foyer et la dispersion des enfants devenus adultes ; une oeuvre de philosophe reconnue, mais dont le noyau vital aujourd'hui pourrait bien avoir implosé, face au mur de la réalité mise à sac : les théorisations, le maniement rigoureux des concepts, l'envie dévorante -parfois- de chercher encore, sont toujours là, mais noyées dans une apathie, une mélancolie insoutenables. En guise de nouvelles connaissances enfin, et de fermes attaches à ce navire qui voudrait se laisser sombrer, un avocat pour le divorce, un psychiatre pour la santé mentale déclinante, une mutation dans une université de seconde zone. Des agents de l'IRS déterminés à produire une irrégularité dans le dossier fiscal ... et l'achat impulsif, irraisonné croirait-on, dans les "Montagnes Infinies", d'une maison à la campagne. Prétendument hantée.
Le décor en est ainsi planté et Mickelsson y déambule avec sa carcasse fatiguée ; avec son vieux pénis, et son coeur, qui actionne les pompes là haut, et le voit se prendre d'affection pour une jeune prostituée, sans qu'il ait pu s'y attendre. Il ne prévoyait pas non plus de tomber en admiration devant une de ses collègues sociologue, qui accepte d'entamer une relation avec lui, caractérisée par la prudence et l'envie.
Ses amours naissants et simultanés lui paraissent marqués du sceau de l'infâmie, porter le signe des défaites de la vie antérieure, et suscitent en lui pitié, sidération à son propre égard. Il est incapable de leur imaginer une issue ailleurs que dans l'oubli ou l'indifférence. Car oui, comment juger de soi lorsque l'on a failli massivement par le passé, et que l'on analyse le moindre de ses actes à l'aune de sa colère, dont les feux viennent trop tard, quand tout s'est déjà lentement effondré ? Comment parvient-on à survivre lorsque l'on crible de flèches ses propres et dernières impulsions vitales, qu'on les raisonne sans relâche, dans un tourbillon rhétorique nourri d'insomnies, de défiances à l'égard du monde peuplé d'individus normaux, désespérément heureux, agissants, vivant en masse, aux portes même de la nuit finissante ?
Mickelsson a du coeur, mais est un redoutable antagoniste, certes effrayé par la disparition, en lui, de l'ancienne puissance égotique de celui a qui tout réussissait ; le pathétique de son personnage disparaît toutefois derrière la capacité de nuisance qu'on lui devine, même si elle se dirige avant tout contre lui.
Le souffle s'emballe lentement, pour croître en intensité dramatique, et nous apprenons peu à peu quel est l'héritage de Mickelsson.
La symphonie des spectres est un roman fleuve : entendons par là qu'une fois commencé, il y a peu de chance que se présente l'envie de le lâcher ... il porte avec lui une authentique matière dramatique, enfoncée jusqu'au cou dans l'aberration, mais toujours vraisemblable.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 3 Août 2014 à 00:31

Le livre de Pete Dexter, Spooner, cache bien son jeu. Si on nous présente la situation de façon si froide, voire drôlatique (une naissance prévue pour des jumeaux, qui n'en verra qu'un survivre), et que le texte se refuse à donner dans le grandiloquent, c'est qu'un long chemin nous attend.
Avant tout, il conviendra de poser le décor, sur un ton laconique, mais de façon précise : la mère, ou plutôt ce qu'il en restera, après un tel évènement ; lequel arrive dans sa vie après la mort de son père, et quasiment en même temps que la mort de son mari.
"Cela étant, personne qui connût même vaguement Lily n'aurait songé à lui dire qu'il comprenait ce qu'elle avait enduré, certainement pas un médecin ou un parent, et si, un après-midi, un mois ou un an après les faits (imaginez-la au lit, aux prises avec une crise d'asthme), elle comparait tout à coup l'horreur de donner naissance à des jumeaux - elle en avait perdu un, voyez-vous - à une amputation sur champ de bataille, qui allait la contredire ? Vous ? Vous êtes dingue ? [...] Et vous la fermiez, même si vous vous teniez à son chevet sur des moignons, en uniforme de l'armée des Etats-Unis, des rubans et des médailles alignés sur la poitrine comme des bacs de pétunias à un balcon."
Voilà pour le personnage de Lily, qui au début sa sa vie est déjà comblée par les catastrophes. C'est qu'il lui reste un nouveau-né survivant, Warren Spooner Whitlowe, et pas le meilleur des deux, se mettra-t-elle à penser, alors qu'il grandit ; un genre d'enfant terrible, sans la méchanceté.
Puis viendra Calmer. Le futur ex-capitaine de frégate de l'armée, à qui ses supérieurs confient l'appareillage d'un vaisseau, chargé de l'immersion du cercueil d'un député, en grande pompe. Les choses vont plutôt mal se passer durant la cérémonie, jusqu'à virer au scandale. Gentiment remercié, destitué, il s'embarque vers Milledgeville, où vit Lily.
Leur rencontre, et le rapprochement qui s'ensuivra, feront de Calmer Ottosson le beau père de Spooner.
Cette histoire sera donc celle d'une famille, vue sous le prisme de Spooner, un enfant dont on hésiterait à dire que les frasques qu'il commet proviennent de sa situation natale, vrillés de psychanalyse comme nous le sommes (au moins autant que sur-imprégnés de culture judéo-chrétienne, non ?). Quant à son idiotie présumée ... Spooner, dans sa façon d'appréhender les choses, de découvrir le monde, présente de nombreux signes d'inadaptation aux normalités requises ; son corps parle parfois spontanément, quand ce n'est pas son cerveau, même alourdi, qui est en cause. Une institutrice, découvrant son érection alors qu'elle posait une main sur son crâne, pourrait en témoigner, en professionnelle. Le médecin de famille, qui essaiera de lui faire avouer qu'il prend plaisir à torturer les animaux, semble avoir lui-aussi quelques certitudes à son égard. Spooner n'aurait pas grand monde de son côté, si ce n'était la présence d'un homme de bon sens, et même de haute vertu, en la personne de Calmer. Ce dernier regardera les divers diagnostics formulés sur Spooner avec circonspection ; davantage concerné, apparemment, par le manque de discernement de ceux qui les ont formulés. Il sent bien que quelque chose se passe, dans la tête de ce gosse, quelque chose qu'il connaît vaguement. Une chose que l'on ne nommerait pas mal de vivre, mais fronde généralisée, ou bien regard en biais ? Conscience de soi à éprouver ? Le regard de Calmer semble ausculter, apprendre de Spooner, autant que son comportement le déroute. Et l'interrogation muette qui, elle, coule des lèvres de Spooner, a trait à ce regard que l'on pose sur lui, sur sa consistance. Rien qui puisse se dire, à seulement considérer que le dire aie, ici, la moindre place à occuper. Ce livre est peut-être l'histoire non autorisée d'un tel regard, de ce qu'il renferme, et des liens qui se tisseront autour.
Au fil des années, nous suivrons donc Spooner, jusqu'à un âge avancé. A l'opposé de ses frères et soeurs, tous brillants, se dessine le portrait d'une famille qui ne semble vivre que dans ses contrastes, dans une certaine forme de bonheur parfois.
Gueule cassée, (et jusqu'à quel point, il faudra lire pour le savoir) le "héros" de cette histoire doit faire un certain apprentissage, celui de la marche à rebours. Jusqu'au point où être soi, sans couler de source pour autant, épargne les ridicules, les tragédies. Cesser, si possible, de se prendre trop au sérieux, si cela signifie courir à sa perte.
Drôle, sombre, profond, tout en faisant l'économie absolue du pathos. Pete Dexter est très convaincant. Et Spooner inoubliable. votre commentaire
votre commentaire
-
Par Erlkoenig le 16 Juin 2014 à 14:19
Inventer sa solitude, ou s'individuer.
Et présider, en conscience, aux déploiements de l'écriture à venir. Tenter d'en approcher le noyau ; l'absence de tout romantisme, vis-à-vis de la question de l'écriture, guide Paul Auster (s'en tenir aux faits objectifs, ceux de la réalité physique d'un corps, sinon de sa position dans un lieu donné).
C’est que tout commence par là. Etre assis devant un bureau. "Table de travail". Se situer dans un tel espace, sans rien perdre de l’extérieur pourtant ; être enfermé, mais sentir, jusque dans ses os, que ce confinement s’impose, et qu’il parle, longuement. Et ainsi, ouvrir la voie avec un premier texte, le « Portait d’un homme invisible ».
L’homme invisible, c’est le père, dont la vie intérieure, la présence même semblent relever du bruit blanc. Des mots, des souvenirs ; leur écho, à l’épreuve du réel, poursuit le travail de l'absence, cette fois consommée par la mort.
Deviner la nature d'un vertige intérieur, le sien, propre, à l'aune de la disparition d'un père. La solitude de celui qui écrit "dans la chambre" se partage avec celles des ombres côtoyées ; on devient, pour soi-même et pour se trouver, ou pour un autre, un "bloc d'espace impénétrable".
Ecrire, une absence nécessaire pour être au monde, et répondre à la voix d'un enfant : celui qui a attendu son père, il y a tant d'années, sans le rencontrer. Et celui qui, aujourd'hui, entend entraîner son père avec lui : plus loin, dans le dédale que la chair, et le souvenir, dessinent pour eux.
« Le livre de la mémoire », seconde partie de « L’invention de la solitude », évoque, en plus des mystères de la filiation, le lien fondamental entre le présent et les époques révolues. L’identité circule entre ces pôles de stabilité avec une conscience d’elle-même de moins en moins certaine, ou arrêtée. Des figures historiques (Anne Frank, Israel Lichentenstein), bibliques (Jonas et la Baleine), artistiques (Vermeer, Collodi et son Pinocchio) viennent éclairer la solitude comme épreuve ontologique, et les postures créatrices, pour soi, qu’elle peut favoriser, mais qui peuvent, ou doivent être mises en place pour la survie même ; une façon de cheminer dans le labyrinthe Austérien. Ou, comme le dit justement P. Bruckner : le fondement même de « « l’art poétique » de P. Auster.
 5 commentaires
5 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
... ceux-ci d'or.